Philippe Delestaing est bibliothécaire et militant des communs et des licences libres.
Aaron Swartz était un chaud partisan de la licence globale qui pourrait être prélevée sur les fournisseurs d’accès à Internet pour rémunérer les auteurs dont les œuvres seraient en accès libre. A-t-elle des chances de voir le jour ?
Non. Elle n’a aucune chance de voir le jour. Disney retire ses films de Netflix, de nouveaux distributeurs vont se faire concurrence entre eux, si on veut avoir accès aux mêmes choses qu’avant, il va falloir payer cinq, six, dix fois plus, ce qui va augmenter le piratage. Et ça ne va absolument pas dans le sens d’une licence globale qui aurait été la solution la plus simple et la plus efficace. Ça tuerait le piratage, car la plupart des gens seraient prêts à payer cinq ou dix euros par mois pour avoir accès aux catalogues d’Amazon ou Netflix dans de bonnes conditions, avec des fichiers de bonne qualité, des sous-titres dans toutes les langues...
Il y a des décisions qui se prennent au niveau européen en ce moment qui tapent encore sur le peer-to-peer à défaut de pouvoir taper sur autre chose. Ce faisant, ils favorisent le piratage. La Commission européenne a mis de côté une enquête de mai 2015 qui montrait pourtant que le piratage des films n’avait aucun impact sur les entrées en salles [1].
L’accès à tous aux textes du domaine public était un des chevaux de bataille de Swartz. Qu’en est-il en France ?
Les textes dans le domaine public sont relativement accessibles. Le problème à mon sens vient plutôt des textes de la recherche scientifique. Pour les chercheurs aujourd’hui, il faut publier pour être payé et avoir une carrière, ce qui amène à de mauvaises recherches publiées, des problèmes de corruption avec des revues en Asie...
Il faut savoir que ces publications, l’argent public les paient quatre fois ! Comment ça se passe ? Un chercheur fait une recherche, il est généralement payé par de l’argent public. Une fois. Ensuite, l’article est proposé à une revue avec un comité de lecture composé de chercheurs, eux aussi payés avec de l’argent public. Deux fois. La revue demande alors à l’université de faire la mise en page des articles. Trois fois. Et enfin, l’éditeur publie la recherche et il faut payer une fortune pour y avoir accès. Quatre fois.
« Tout ce qui est financé par de l’argent public doit être dans le domaine public »
Un chercheur du côté de Toulouse avait fait publier un résultat de recherche dans une revue et l’avait aussi publié sur son blog. Il s’est fait attaquer par la revue pour avoir publié sa propre recherche. Ces éditeurs qui trustent 80% du marché universitaire ne sortent pas un euro mais récoltent tout.
Il y a pourtant des alternatives. Le site HAL propose des archives ouvertes en français et en accès libre. Ce n’est pas du domaine public à proprement parler, même si ça devrait l’être. A mon sens, tout ce qui est financé par de l’argent public doit être public, que ce soit du code source, du texte ou de l’image. L’image c’est un autre problème. Avec les attaques contre l’exception de panorama, on n’a même plus le droit de prendre des photos de vacances et les publier parce qu’il y a un droit sur tel immeuble ou tel design architectural.
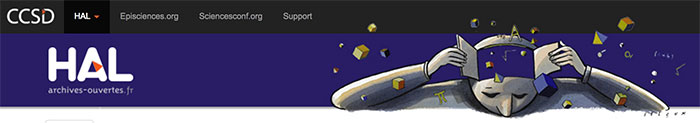
Il y a un problème avec la reconnaissance du domaine public, en France il est défini négativement : c’est l’ensemble des œuvres sur lesquelles il n’y a plus de droits. Avant les licences Creatives Commons, aucun texte juridique ne permettait aux créateurs de mettre à disposition leur œuvre, ce n’était pas possible.
Le droit d’auteur en France, c’est soixante-dix ans après la mort...
Mais ça n’a pas toujours été le cas ! Au 18e siècle, l’idée était que pour les pièces de théâtre, l’auteur avait les droits sur son œuvre pendant trois ans, le temps d’écrire une autre pièce. Après, c’était libre. Aujourd’hui, les droits courent soixante-dix ans après la mort de l’auteur. Les arrières petits-enfants continuent à toucher une rente de situation. Le Petit Prince de Saint-Exupéry n’est pas dans le domaine public, on est le seul pays dans le monde dans ce cas. Pourquoi ? Parce que l’auteur est mort pour la France, donc ça rajoute trente ans.
Aux Etats-Unis, il y a l’amendement Mickey. Normalement, Mickey aurait dû tomber dans le domaine public, mais un artifice juridique a permis à Disney de continuer à exploiter le personnage de Mickey. Il y a une vraie opposition entre diffuseurs, éditeurs et créateurs. Ils n’ont pas du tout les mêmes objectifs. Alors que la création se nourrit de la création : personne n’invente quelque chose ex-nihilo. Si maintenant pour le moindre mot il faut voir s’il n’est pas déposé quelque part, ça tue juste la création.
« Le Rijksmuseum a mis 100 000 documents sous licence Creative Commons »
Les seuls qui en profitent sont les distributeurs et dans une moindre mesure les éditeurs. Mais certainement pas les auteurs. Quand le musée d’Orsay interdisait de prendre en photo des tableaux de 200 ans, c’était illégal. Mais c’était le réglement du musée. Des gens se sont fait sortir par les flics pour avoir pris en photo un tableau. Jusqu’à ce que Fleur Pellerin se fasse prendre en photo devant un tableau qui n’était pas dans le domaine public !
Dans le même temps, le Rijksmuseum d’Amsterdam a mis 100 000 documents sous licence Creative Commons, la bibliothèque du Congrès a fait pareil avec des photos, des cartes postales et des documents historiques. C’est le patrimoine de l’humanité, c’est la propriété de tous, donc de personne.

La firme Proquest a passé un partenariat public privé en 2013 vec la BnF pour numériser à ses frais des ouvrages en contrepartie d’un accès payant pour les bibliothèques universitaires. N’est-on pas dans le même cas de figure que JSTOR ?
C’est de la privatisation du domaine public. Ce qu’ils disent faire payer, c’est l’acte de numérisation, mais en fait c’est l’accès à un document qui fait partie du domaine public. Google essaie de faire pareil en essayant de privatiser un logiciel sous licence libre, un peu comme ils ont fait pour Android.
Quel est l’intérêt pour la BnF de faire ça ? Parce qu’elle n’a pas l’argent pour numériser ? Ou le contexte de privatisation rampante ?
Il y a l’idée de lutter contre le domaine public. Ce sur quoi personne n’a la main et faire du profit, ça gêne. C’est pourquoi il y a des initiatives intéressantes qui se font en bibliothèque, où on montre comment utiliser le domaine public, se l’approprier, y contribuer. D’où l’intérêt de Wikipedia, on peut corriger une faute ou écrire un article entier. C’est vivant, protéiforme et pas maîtrisable pour les autorités. L’un des gros problèmes, c’est celui-là.

Apple est aussi partenaire de la BnF pour commercialiser des livres numériques. Le domaine public serait-il le nouvel eldorado des GAFAM ?
C’est une énorme masse de connaissances qu’ils veulent récupérer pour les revendre, car c’est plus facile que de créer de nouveaux contenus.
Ces grosses boîtes s’insinuent dans tous les domaines publics. Comme le ministère de la Défense qui renouvelle le contrat open bar avec Microsoft. Une cellule de Microsoft travaille au ministère pour adapter les logiciels. Sachant que Microsoft fait partie du programme Prism de la NSA, donc cette dernière a accès à toutes les informations qu’elle veut, potentiellement au moins.
« L’école habitue les enfants aux tablettes plutôt qu’aux logiciels libres »
Il y a eu pire peu de temps avant. Quand il a fallu renouveler les serveurs de la Défense et des services de renseignement, c’est IBM qui devait les fournir, mais Lenovo a racheté la branche serveurs d’IBM. Lenovo, société chinoise qui met des mouchards sur son matériel. On nous dit que Lenovo est une société privée indépendante. Ça n’existe pas, toutes les entreprises chinoises qui font de l’export sont contrôlées par le gouvernement.
Pareil pour l’Education nationale avec Google, Apple et Microsoft. Des enseignants se battent pour utiliser les logiciels libres. Mais ils ne font pas le poids, car l’Education nationale habitue les enfants à utiliser les tablettes et le matériel de ces sociétés. Pareil pour la DRAC qui finance la culture en payant des tablettes et des liseuses, alors que pour acheter des livres il n’y a pas d’argent.
Les bibliothèques sont en pleine mutation, avec des demandes différentes de la part du public alors qu’Internet propose un accès à une somme de connaissance et de partage des savoirs inédite dans l’histoire humaine. A quoi pourrait ressembler la bibliothèque de demain ?
L’avenir, ce n’est pas des bibliothèques sans livres avec des tablettes et des liseuses partout. La différence avec ce qu’on trouve en bibliothèque et Internet, notre fonds documentaire est sélectionné avant, c’est notre plus value. On doit apprendre au public à faire des recherches, analyser l’information qui circule.
On va vers moins de livres, mais pas qu’à cause d’Internet. Déjà parce qu’il y a moins de gros lecteurs qu’il y a dix ans, ceux qui lisent au moins un livre par mois. Pour des questions de temps, parce qu’il y a d’autres médias qui les occupent...
Les bibliothèques ont un rôle à jouer dans l’accès du public à l’information. A des livres, à Internet... Il faut lui donner des outils pour discriminer l’information.
Alors que la marchandisation des services va bon train, se développe à côté toute une culture des communs [2], comme par exemple le site wikifab. Comment le service public pourrait-il participer à ce mouvement ?
Je suis convaincu qu’on a notre place en tant que service public. Les bibliothèques sont-elles un commun ? La vision que j’ai du rôle de la bibliothèque, c’est donner des outils à nos lecteurs pour être des citoyens libres, avec tout ce que ces mots comportent. Si on présente des logiciels libres, ce n’est pas pour dire que c’est mieux que les autres, c’est pour leur présenter quelque chose qu’ils ne connaissent pas.A eux de faire leur choix.

Quelles sont les trois composantes d’un commun ? Il faut une ressource, des gens qui utilisent la ressource et des règles d’utilisation de la ressource. C’est la définition de d’Elinor Ostrom dans ses travaux sur les communs. Ça répondait à un autre économiste des années 70 qui avait écrit sur « la tragédie des communs », voulant démontrer que ça ne marchait pas.
« Gérer la ressource dans l’intérêt de tous »
Ostrom a dit qu’il faut des règles, comme il en existe en Méditerranée avec les prud’homies de pêcheurs ou la gestion de l’eau douce dans les Emirats arabes unis, qui existent depuis des siècles. L’idée n’est pas d’épuiser la ressource pour en tirer le plus de profit possible, mais de la gérer au mieux dans l’intérêt de tous.
Le domaine public, et j’étends ça aux licences libres et aux Creatives Commons, nous avons un rôle à jouer pour que tout le monde puisse s’en saisir, en faisant témoigner des gens qui fonctionnent comme ça, par exemple des banques, de l’immobilier... Les Amaps, aussi. L’idée étant de consommer une ressource et que ce soit pérenne, et de façon locale. On doit être passeurs d’informations pour attirer l’attention des gens là-dessus. Ils en feront ce qu’ils veulent.
Le grand public est-il suffisamment informé de ce qui est fait de ses données personnelles ? Comment le sensibiliser ? Cela ne pourrait-il pas être une mission de service public ?
Pas assez informés, sûrement, même si une enquête du Monde montrait récemment que pas mal de Français sont inquiets, surtout les 18-34 ans, sur leurs données personnelles [3]. Le grand public est-il suffisamment informé ? Certainement pas. Est-ce facile de l’informer ? Pas du tout. Quant on fait des conférences ou des crypto-parties, on touche surtout le public déjà informé.
Le plus difficile, c’est qu’il faut changer ses habitudes, alors que la notion de vie privée a tendance à se diluer. Je travaille là-dessus depuis des années, c’est très compliqué. Les informaticiens sont très compétents, mais ils font des choses extrêmement efficaces mais inutilisables par le grand public parce que c’est trop compliqué, ou l’interface est moche.
Il y a des initiatives intéressantes, comme Cozy Cloud. C’est une solution qui repose sur des logiciels libres, on peut ajouter des fonctionnalités, l’objectif est d’être auto-hébergeable. On peut accéder facilement à nos données, mais elles seront à la maison, pas chez Google.

A l’inverse, le W3C permet maintenant à des entreprises tierces d’avoir le contrôle du navigateur. Donc une entreprise extérieure va décider à ta place si tu as le droit d’accéder à un contenu. Je ne comprends pas qu’on en soit encore au DRM alors que ça ne marche pas, maintenant on le met sur les sites web. Il y a deux mouvements qui vont entrer en collision, entre ceux qui veulent se saisir de ce qui nous appartient collectivement, et ceux qui veulent mettre des restrictions d’accès partout.
Mais c’est le reflet de ce qui se passe dans la société, partout dans la rue, des restrictions de liberté, avec des militaires armés, des vigiles qui fouillent à l’entrée des magasins ou à la gare. Les restrictions de liberté deviennent la norme. C’est pareil dans le monde numérique. C’est effrayant.
Le web a toujours été un problème. Quand on nous dit que c’est une zone de non-droit, c’est faux. Le droit s’applique partout, mais Internet était un lieu où on peut parler et échanger librement sans surveillance. Maintenant c’est trop tard.
On aurait bien besoin d’Aaron Swartz aujourd’hui pour continuer à se battre...
Oui, ou comme le fait Lawrence Lessig, qui lance une campagne aux Etats-Unis en disant que le système d’élections présidentielles est anticonstitutionnel. Le principe des grands électeurs (le candidat arrivé en tête dans un Etat emporte tous les grands électeurs) prive ceux qui n’ont pas voté pour le candidat de leur expression. Or la constitution américaine dit « un homme, un vote ». Il fait donc une campagne pour que chaque voix compte.
Plein de gens se battent en France, la Quadrature du Net fait un boulot remarquable mais très coûteux en terme humain, c’est épuisant ce travail-là. Ils essaient de faire passer des choses auprès des députés, les députés font des copier-coller de ce que les lobbies leur envoient. La force de frappe n’est pas la même.
« C’est un droit inaliénable du citoyen que d’être libre »
Il y a quand même une prise de conscience, de plus en plus de gens se posent des questions. A la fin du mois va sortir un documentaire, Nothing to hide en libre accès sur Internet. Il y a de plus en plus de crypto-parties pour apprendre aux gens à protéger leurs données personnelles et leurs communications. En France, les députés les plus en avance là-dessus n’ont pas été réélus, comme Sergio Coronado ou Isabelle Attard.
Il y a une vraie nécessité de nouveaux Aaron Swartz. Et encore une fois, le service public a un rôle à jouer. C’est un droit inaliénable du citoyen que d’être libre. Notre rôle, c’est de l’aider à aller dans ce sens-là, pas le contraire.