C’est la sensation qu’on éprouve quand on termine un puzzle particulièrement gratiné, de plusieurs milliers de pièces, et qu’on a enfin une vision d’ensemble du tableau. Du soulagement, de la satisfaction (en particulier quand l’image est belle) et un peu de tristesse d’en avoir fini avec une activité dans laquelle on s’est plongé si longtemps.
Pour 4 3 2 1, comptez une bonne quinzaine d’heures de lecture. Il faut bien ça pour venir à bout de 1016 pages du dix-neuvième roman de Paul Auster, de très loin le plus dense qu’il ait jamais écrit. Mais outre sa longueur, la forme même du récit nécessite de fréquents allers-retours d’un chapitre à l’autre : ce n’est en effet pas une histoire qui est racontée mais quatre différentes et autonomes, découpées chacune en sept chapitres alternés. On passe ainsi du 2.1 au 2.2 puis au 2.3, soit le deuxième chapitre de la première histoire, puis le deuxième de la deuxième histoire, et le deuxième de la troisième histoire.
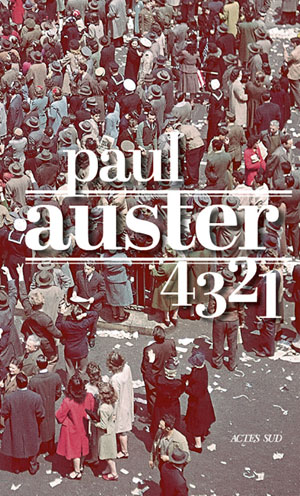
Pour ne pas s’y perdre, il y aurait bien entendu la solution de facilité qui consisterait à ne lire qu’un chapitre sur quatre (le 1.1, puis le 2.1, le 3.1 et ainsi de suite jusqu’au 7.1) afin de reconstituer chronologiquement chaque histoire. C’est d’ailleurs ce que je ferai à la prochaine lecture.
Mais un roman n’est pas une encyclopédie, et si l’auteur a choisi un mode narratif, autant que le lecteur le respecte. Le plus simple, pour ne pas perdre le fil d’un chapitre à l’autre (chacun pouvant faire une cinquantaine de pages, soit la dimension d’une nouvelle), étant de revenir en arrière pour lire les dernières lignes du précédent de la même histoire.
Cinq cercles concentriques qui fusionnent en un disque noir
4 3 2 1 raconte donc quatre versions de la vie d’un même personnage, Archie Ferguson, de sa naissance à ses 25 ans. Mais comme il naît le 3 mars 1947, soit un mois tout juste après Paul Auster, et à Newark comme lui, il va sans dire que le roman est une sorte d’autobiographie fictive à quatre variantes. C’est aussi un formidable livre d’histoire sur les années cinquante et soixante aux Etats-Unis, de la période d’Eisenhower à celle de Nixon en passant par JFK et Lyndon Johnson, mais aussi Martin Luther King, la lutte pour les droits civiques, les émeutes urbaines et, comme une immense épée de Damoclès, la guerre du Viêtnam.
Auster a d’ailleurs une formule extraordinaire pour décrire la situation d’un jeune étudiant qui a vingt ans en 1967 et sur qui plane la menace de l’enrôlement. Il en fait une figure géométrique de cinq cercles concentriques, le plus large étant le monde avec la guerre en Asie, puis un plus petit englobant l’Amérique, un autre contenant New York, un quatrième l’université de Columbia, un cinquième les proches de Ferguson, ce dernier étant le point central de l’ensemble.
La guerre ne cessait de prendre de l’ampleur, et plus elle se développait plus le premier cercle écrasait les quatre autres, les pressant de plus en plus les uns contre les autres, et bientôt l’espace entre eux s’était réduit à une fine couche d’air, ce qui rendait la respiration difficile à ceux qui étaient piégés, seuls au centre.
Et, juste après l’assassinat de Martin Luther King :
Les cinq cercles concentriques s’étaient fondus en un seul disque noir.
Le roman a aussi une indéniable dimension politique, tant le racisme traverse toujours la société américaine. Et ce, explique Auster [1], parce que les Etats-Unis se sont construits sur un très mauvais compromis, celui de la Constitution de 1787 disant que les esclaves compteraient pour trois cinquièmes d’êtres humains. 4 3 2 1 se déroule cent ans après la Guerre de Sécession, mais la question raciale y est omniprésente, notamment dans la descriptions des émeutes de Newark en juillet 1967 ou à l’université de Columbia en avril-mai 1968.

Déconstruction du discours
Car si Auster joue avec les possibles en imaginant quatre vies différentes pour Archie Ferguson, 4 3 2 1 n’est en aucun cas une uchronie. Le contexte historique est le même dans les quatre variantes, et il est documenté avec une précision remarquable et une inventivité permanente. Le discours d’investiture de John Kennedy en janvier 1961 est ainsi déconstruit et éparpillé comme un puzzle minuscule à l’intérieur d’un puzzle géant, à la fois touchant par la profondeur des formules et renvoyé à sa nature profonde, un enchaînement de mots, ce qu’on appelle aujourd’hui des éléments de langage. Et l’assassinat de ce même JFK, mille jours plus tard, donne lieu à cette phrase parfaite :
Deux routes divergeaient dans une ville fantôme et l’avenir était mort.

Archie Ferguson lui-même n’est pas radicalement différent dans ses quatre versions. C’est plus ce qui lui arrive et la place qu’il trouve dans sa vie amoureuse, ses relations amicales, sa famille et ses études qui varie. Que serions-nous devenus si un de nos parents était mort alors qu’on avait neuf ans ? Ou si nos parents s’étaient séparés ? Ou s’ils avaient fait fortune ? Quelle serait notre vie sexuelle si la fille qu’on aimait à quatre ans était tombée amoureuse de nous à seize ? Ou si notre première expérience marquante avait eu lieu avec un garçon plutôt qu’une fille ? Et si notre ami le plus proche était mort subitement à quatorze ans ? Si un accident de voiture nous avait mutilé alors qu’une grande carrière sportive s’ouvrait à nous ?
Voilà comment Auster décrit la contingence, le hasard, la bifurcation :
Tout est parfaitement solide pendant un temps puis un matin le soleil se lève et le monde se met à fondre.
Le temps se déplaçait d’avant en arrière
Ce flottement entre les possibles, cet exercice de style qui pourrait s’étendre dans toutes les directions et indéfiniment, Auster le résume en deux phrases :
Tout le monde avait toujours dit à Ferguson que la vie ressemblait à un livre, une histoire qui commence à la page 1 et qui se déroule jusqu’à la mort du héros page 204 ou 926 mais maintenant que l’avenir dont il avait rêvé changeait, sa notion du temps changeait aussi. Il comprit que le temps se déplaçait en avant et en arrière.
Stephen King, né la même année qu’Auster, sept mois plus tard, avait affirmé avoir écrit Sac d’os (Bag of Bones, 1998) en imaginant ce qu’aurait été sa vie si sa femme était morte prématurément. C’est le même principe ici, poussé un peu plus loin.

A soixante et onze ans (il les aura le 3 février prochain), Paul Auster a retrouvé le souffle qui traverse ses plus grands romans comme Léviathan (1993), Moon Palace (1990), Mr Vertigo (1994) ou le Livre des illusions (2002). Son secret ? « J’écris chaque livre comme s’il devait être le dernier. Alors, une impulsion nouvelle me soulève ». [2]. Et nous avec.