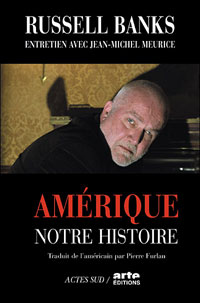
Qui pourra autopsier l’histoire de France avec autant de lucidité et de précision que ne le fait Russell Banks pour l’Amérique ? C’est autant l’écrivain - et son style limpide et puissant - que l’enseignant - et son sens de la pédagogie - qui s’expriment en réponse aux interrogations de Jean-Michel Meurice. Pourquoi les Européens ne comprennent pas les Américains ? [1] Parce qu’ils ne les connaissent pas. Russell Banks apporte ainsi des éléments de compréhension particulièrement pertinents.
L’Amérique des premiers pélerins s’est construite sur trois rêves : un monde vertueux et pur débarrassé de la décadence européenne, un lieu où le pauvre peut s’enrichir sans entrave, un pays où chacun peut renaître et redevenir enfant. Mais il n’y a pas que ça : « dès le départ, la différence raciale prend une place centrale dans l’imaginaire américain. Et elle l’occupe toujours. » Ainsi s’explique la vision du reste du monde par les Américains, notamment envers les Asiatiques, les Arabes ou les Africains. Les stéréotypes raciaux sont si puissants qu’ils sont utilisés pour parler de tous ceux qui sont différents de la norme (blanche, anglo-saxonne, protestante), peu importe que ces différences soit religieuses ou linguistiques. Ainsi, pendant très longtemps, les Irlandais et les Italiens (parce qu’ils étaient catholiques) étaient décrits dans des termes proches de ceux utilisés pour les Noirs.
Autre trait essentiel pour comprendre l’esprit américain : l’indifférence pour le passé, voire même le déni, et que Banks explique par l’artificialité de l’identité nationale (l’Américain de souche n’existe pas, tout le monde compte des émigrants dans sa famille). « C’est un moteur puissant, ce rêve américain. Il est peut-être psychotique, mais il n’en est pas moins fort. Car d’une certaine façon, il faut être psychotique pour croire qu’on peut refaire sa vie et que le passé n’existe pas. » Psychotique et schizophrène, en permanence tiraillé entre ce désir de pureté et ce besoin viscéral de s’enrichir, par tous les moyens.
Pour illustrer cela, Russell Banks prend l’exemple de la première guerre mondiale. Au début du 20ème siècle, les Américains se sentaient beaucoup plus proches de l’Allemagne que de la France. Et s’ils se sont décidés à entrer en guerre en 1917, ce n’est pas pour sauver l’Europe, mais bien pour préserver les échanges commerciaux menacés par les sous-marins allemands qui coulaient la flotte marchande américaine. « La politique étrangère, aux Etats-Unis, est historiquement soumise à l’économie [...] Nous considérons nos valeurs et nos besoins comme plus importants que ceux de n’importe qui d’autre sur cette planète. »
Le résultat de toutes ces contradictions, c’est une tension telle entre l’idéal et la pratique qu’elle ne peut déboucher que sur des explosions de violence. « D’une certaine façon, nous sommes un peuple schizophrène, [...] une nation de rêveurs homicides [...] Nous sommes en guerre contre nous-mêmes. Ce qui explique, me semble-t-il, que nous partions si souvent en guerre contre les autres : afin d’éviter de nous en prendre à nous-mêmes. »