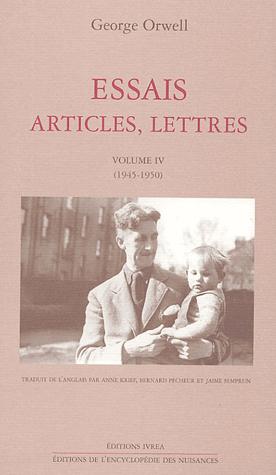
Ce recueil se situe entre la parution d’Animal Farm (1945) et celle de 1984 (1949), entre le décès de sa première femme d’Orwell, Eileen (en mars 1945) et son mariage avec Sonia Brownell (octobre 1949). Ce qui rend cet ouvrage si émouvant, c’est que dès le début, on sait que le temps de l’écrivain est compté. Lui ne le sait pas encore, du moins jusqu’au début de l’année 1949 où il commence à parler de sa fin possible, et même lorsqu’il tombe gravement malade (tuberculose) en 1947, il pense pouvoir en guérir.
Cette échéance fatale colore du coup ses propos, du moins ceux des lettres qu’il écrit à ses amis ou à son éditeur (Warburg). Il leur explique ses souffrances, son traitement, son immense fatigue qui l’empêche de travailler à son roman qui n’est rien d’autre que 1984. Il ne peut quitter son lit qu’une poignée d’heures chaque jour et se languit de revoir son fils adoptif, alors âgé de quatre ans, qu’il craint de contaminer.
On ne peut s’empêcher de penser à ce qu’il aurait pu produire s’il avait vécu dix ou vingt ans de plus, sachant que ses deux derniers romans (La ferme des animaux et 1984) sont aussi les plus connus parmi son œuvre. La guerre froide, l’engagement militaire américain en Corée, la mort de Staline, la révolution chinoise, la construction européenne et la décolonisation de l’Afrique sont advenus après sa mort.
Parmi de très nombreuses pépites, il y a un texte étonnant sur Tolstoï (Lear, Tolstoï et le bouffon) où Orwell démonte avec férocité un pamphlet de l’auteur de Guerre et paix contre Shakespeare.
« Tolstoï n’était pas un saint, mais il s’est efforcé avec acharnement d’en être un, et les critères qu’il appliquait à la littérature n’étaient pas ceux de la vie terrestre. »
On retrouve cette charge contre le principe de sainteté (totalement étranger à Orwell, lui qui défendait au contraire la notion de décence commune) dans l’essai sur Gandhi écrit en 1948. Ce texte, magnifique, commence fort :
« Jusqu’à preuve de leur innocence, les saints doivent toujours être considérés comme coupables. »
Puis, plus loin,
« Etre humain consiste essentiellement à ne pas rechercher la perfection, à être parfois prêt à commettre des péchés par loyauté, à ne pas pousser l’ascétisme jusqu’au point où il rendrait les relations amicales impossibles, et à accepter finalement d’être vaincu et brisé par la vie, ce qui est le prix inévitable de l’amour porté à d’autres individus. Sans doute l’alcool, le tabac et le reste sont-ils des choses dont un saint doit se garder, mais la sainteté est elle-même quelque chose dont les humains doivent se garder. »
Plus on avance dans le recueil, plus les textes se font intimes. Après le déclenchement de la phase finale de sa maladie, en avril 1947, on trouve de moins en moins d’articles et de recensions de livres, et de plus en plus de lettres, lesquelles sont de plus en plus courtes. Hormis deux textes remarquables, l’un sur les mémoires de Winston Churchill, l’autre sur Gandhi, où l’on retrouve le style dépouillé et précis de l’auteur d’Hommage à la Catalogne et des chroniques A ma guise.
La dernière phrase du dernier texte du recueil, qui n’est pas le dernier écrit chronologiquement, est bien dans le style d’Orwell, direct et sans aucune fioritures :
« A cinquante ans, chacun a le visage qu’il mérite. »
Lui-même meurt le 21 janvier 1950, à quarante-six ans.