C’EST AINSI QUE LES HOMMES TUENT
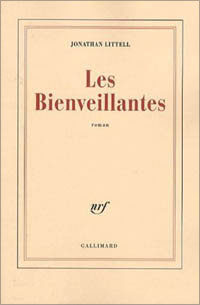
Que va-t-il pourvoir faire après ça ? A 39 ans, Jonathan Littell [1] vient de frapper un très grand coup pour sa première œuvre littéraire. Un sujet terrifiant, monumental et périlleux : les mémoires imaginaires de l’officier SS Maximilien Aue, plongé dans la boucherie sans nom que furent la campagne de Russie, les camps d’extermination et l’effondrement final de l’Allemagne nazie. Neuf cents pages asphyxiantes et indispensables, où se côtoient la barbarie la plus crue, la philosophie la plus noble, la précision la plus froide et, tout simplement, un talent littéraire exceptionnel.
Les critiques citent à propos de Jonathan Littell Dostoïevski, Tolstoï, Vassili Grossman [2] ou encore Robert Merle [3]. Les Bienveillantes [4] me rappellent surtout le formidable et terrifiant livre d’histoire contemporaine de Robert Fisk, La grande guerre pour la civilisation. Le même souci du détail, la même mise en évidence de la folie meurtrière, de l’infinie bassesse des hommes quand ils se coupent de leur conscience. Et bien sûr, l’implacable biographie de Hitler par l’historien anglais Ian Kershaw [5].
Comme Robert Fisk, qui vit depuis trente ans à Beyrouth et qui a couvert tous les conflits du Moyen-Orient, Jonathan Littell sait de quoi il parle quand il décrit les villes russes ravagées par l’offensive nazie : pour l’ONG Action contre la faim, il a travaillé sept ans en Bosnie, en Tchétchénie, à Moscou, au Congo, en Afghanistan... Ces charniers à ciel ouvert, ces corps mutilés, ces bourreaux qui posent pour des photographies, ces immeubles éventrés, ces vies dévastées, ils les a vus d’aussi près qu’il est possible de le faire. Puis il s’est documenté, a lu des centaines de livres sur la machine de guerre nazie, sur l’organisation administrative et industrielle dont l’objet principal était la destruction des juifs d’Europe. Et en quatre mois seulement, il a écrit les 900 pages des Bienveillantes.
Dans un village ukrainien, une patrouille SS cherche des partisans. Elle n’en trouve pas, mais soudain, dans la boue qui noie le paysage, une silhouette court. On l’abat. C’est une femme. Elle est enceinte, elle va mourir. Un infirmier allemand demande à ce qu’elle soit transportée à l’abri, et, par une césarienne de fortune, il parvient à sauver le bébé. Fou de rage, un officier SS s’empare alors du nourrisson par un pied et lui fracasse le crâne contre un poêle. Désespéré, l’infirmier attrape un fusil et tue l’officier.
Des scènes comme celle-là, où des bribes d’humanité tentent de surnager dans un océan de folie meurtrière, il y en a beaucoup dans Les Bienveillantes. Et la façon dont Littell les racontent nous forcent à nous interroger sur ce mince vernis de civilisation qui parfois saute au gré des circonstances. Emportés par une vague destructrice sans précédent dans l’histoire humaine, les personnages s’accrochent à ce qu’ils peuvent, les ordres, la doctrine national-socialiste, le pouvoir, l’efficacité bureaucratique.
Puis, quand les circonstances se renversent, à partir de Stalingrad, il ne s’agit plus que de sauver sa peau, coûte que coûte, pendant qu’un tapis de bombes dévaste Berlin et que l’Armée rouge progresse dans la grande plaine polonaise. Alors, aux effroyables descriptions d’exécutions de masse de juifs ukrainiens répondent les ravages d’un char russe écrasant tout sur son passage, chevaux, charrettes et réfugiés, ou encore ces hordes de gamins armés d’outils et qui massacrent les déserteurs isolés dans les bois.
On sort de ces trois semaines de lecture lessivé, épuisé, dans le même état qu’après avoir fini les livres de Ian Kershaw et de Robert Fisk. Quant à Jonathan Littell, il s’est déjà remis au travail : il est en train de traduire lui-même Les Bienveillantes en anglais.