AU-DELÀ DU DERNIER JOUR
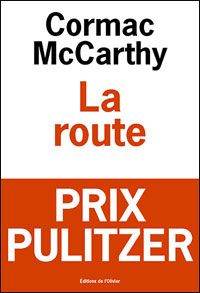
Marcher, marcher jour et nuit dans cette cendre qui recouvre tout, sous un ciel gris et hostile d’où le soleil n’apparaît plus depuis longtemps, marcher dans un paysage ravagé, dans une nature calcinée où la vie a disparu. C’est tout ce qui reste à un homme et son petit garçon dont on ne connaîtra jamais les noms, survivants anonymes d’une humanité suicidée. La fin du monde est arrivée il y a quelques années déjà, avant même que la compagne de l’homme, enceinte, n’ai donné le jour à son fils.
Pourquoi marchent-ils ? Pour fuir ce froid mortel qui tient lieu de climat ? Pour chercher de quoi se nourrir en fouillant désespérément des maisons abandonnées et des villes en ruines ? Pour voir pour la première fois la mer ? Parce qu’il ne leur reste plus rien ? Au lecteur de se faire un avis. Cormac McCarthy, l’auteur de Méridien de sang, De si jolis chevaux et de Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme [1] ne livre aucune clé, aucun indice. Du passé, rien. Quant à l’avenir, il a disparu à tout jamais. Seul compte un éternel présent, où il faut trouver un refuge pour la nuit, de quoi se nourrir, du bois pour faire un feu. Et se protéger des humains.
Il n’en reste pas beaucoup, des survivants, mais il ne fait pas bon croiser leur route. Comme dans Le Fléau de Stephen King, ou dans Le voyage d’Anna Blume de Paul Auster [2], on les aperçoit, fugitivement, devenus chasseurs de chair humaine, armés de casse-tête bricolés avec des matériaux de récupération, ou encore proies capturées comme du cheptel. En ces temps où tout est mort, il faut encore être prêt à tuer pour sauver ce qui reste de vie, en un geste absurde et désespéré qui résume la tragédie humaine.
Sans le petit garçon, qui n’a rien connu d’autre que ce monde d’outre-tombe, l’homme se serait probablement suicidé, la balle qu’il garde précieusement dans son revolver en atteste. Mais l’enfant a l’innocence, le besoin de croire et un amour pur qui le rapprochent du Petit Prince. D’ailleurs, son père lui affirme « qu’il porte le feu », ultime étincelle d’humanité dans la nuit glaciale tombée sur le monde. Il incarne la fragilité de la vie, le fil ténu toujours prêt à se rompre qu’est une existence humaine, et au-delà l’eau, l’air, les arbres, les animaux, « l’éclat d’une luciole dans la nuit, le souffle d’un bison en hiver, la petite ombre qui court dans l’herbe et se perd au couchant » selon la définition d’une sidérante beauté de l’indien Crowfoot.
McCarthy raconte cette histoire sèche et glacée avec un minimum d’effets, phrases courtes, dépourvues de virgules, dialogues minimalistes, description sobre d’un environnement cataclysmique que l’on pourrait comparer à une gigantesque décharge que l’on aurait incendiée. Vision terrifiante et, peut-être prémonitoire, d’une Terre devenue invivable.
« Peut-être que dans la destruction du monde il serait enfin possible de voir comment il était fait. Les océans, les montagnes. L’accablant contre-spectacle des choses en train de cesser d’être. L’absolue désolation, hydropique et froidement temporelle. Le silence. »