VINGT-QUATRE HEURES D’UN VOYAGE CERVICAL
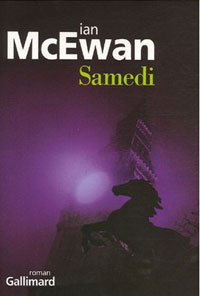
« Il a été projeté dans un pur présent, libéré du poids du passé et du souci de l’avenir ». Une vingtaine de pages avant la fin de Samedi, Ian Mc Ewan traduit en vingt mots l’intention qui traverse de part en part cet étrange objet littéraire. Un peu comme ces peintures hyperréalistes qu’il est si difficile de distinguer des véritables photographies, Samedi est un roman qui approche aussi près que possible de la réalité des choses. Une précision autant spatiale que temporelle : avant d’écrire l’histoire d’Henry Perowne, Ian McEwan a fréquenté pendant deux ans le service de neurochirurgie d’un grand hôpital londonien.
Autant dire que les scènes où Perowne ouvre des crânes pour extraire des tumeurs sont d’un réalisme époustouflant. Même la profusion de termes techniques ne nuit pas à la fluidité du récit. Et à lire ces lignes (« on continuera à s’émerveiller à l’idée qu’une simple masse humide puisse donner [...] l’illusion trompeuse d’un présent immédiat au centre duquel un moi, autre illusion brillamment fabriquée de toutes pièces, flotte comme un fantôme »), on ne peut s’empêcher d’être pris de vertige. Car ce qui nous permet de lire et d’interpréter ces signes imprimés sur du papier, de les transformer en sensations et en souvenirs, c’est bien le cerveau lui-même...
Précision spatiale donc, qui nous plonge dans les replis humides de notre conscience profonde. Précision temporelle, car McEwan contourne remarquablement la contrainte qu’il s’est lui-même imposée, circonscrire son récit dans un laps de temps de vingt-quatre heures. Cette journée qui commence à trois heures du matin, un samedi, et qui s’achève à la fin de la nuit suivante, change constamment de rythme, comme dans la réalité. Le temps s’étire, se contracte, semble s’arrêter dans des moments de stress intense puis accélère brusquement, pendant une partie de squash décrite avec une méticulosité journalistique. Il s’échappe parfois dans des flash-back familiaux ou glisse dans quelques flash-forward (retour en avant) qui spéculent sur l’avenir.
D’ailleurs, si Perowne n’aime pas lire de la poésie, c’est parce que « les romans et les films vous projettent au rythme haletant de la modernité dans le passé ou dans l’avenir, enjambant les journées, les mois, les années, voire les générations. Or, la poésie, pour parvenir à ses épiphanies, se tient en équilibre sur la tête d’épingle du moment présent. » C’est pourtant exactement ce que fait McEwan, en prose et sur 350 pages.
Cet Henry Perowne, représentant type des classes supérieure (maison de six cents mètres carrés à Londres, femme conseillère juridique, fils musicien de jazz, fille poétesse) à l’existence confortable et conformiste, qu’a-t-il de si intéressant ? C’est moins lui qui accroche la lecture que ce qui lui arrive au cours de cette journée apparemment banale. Car McEwan inscrit son histoire dans la grande : on croise ainsi Tony Blair - dans une scène décapante qui met à nu le sens de la mise en scène des dirigeants politiques - et la manifestation géante contre la guerre en Irak, qui permet de situer exactement de quel samedi il s’agit : le 15 février 2003, 750 000 personnnes défilent dans les rues de Londres, dix millions dans le monde. Ça n’empêchera pas les Etats-Unis d’attaquer l’Irak le 21 mars, avec le résultat que l’on sait.
Dans la famille Perowne, les avis sont partagés : si Henry est plutôt blairiste (Saddam est un tyran, la démocratie viendra peut-être après la guerre), son fils Theo s’occupe plutôt de ses répétitions, alors que sa fille Daisy est farouchement pacifiste. Il est d’ailleurs significatif de noter l’irruption de la guerre en Irak dans les romans contemporains, comme Lignes de faille de Nancy Huston.
Pourtant, impossible de mépriser cet Henry Perowne. C’est un être fondamentalement honnête, qui tente de mener sa vie au mieux et qui, en vrai médecin, se sent toujours disponible à venir en aide à son prochain, quel qu’il soit et quoi qu’il ait fait. Le dénouement du roman, tout à fait inattendu (bien que rétrospectivement évident) est tout entier contenu dans cette phrase magnifique : « C’est alors qu’ils nous offrent un aperçu de ce que nous pourrions être, de ce que nous avons de meilleur, de ce monde impossible où on donne tout aux autres sans rien perdre de soi-même ».