LE TROU NOIR DE LA GUERRE MODERNE
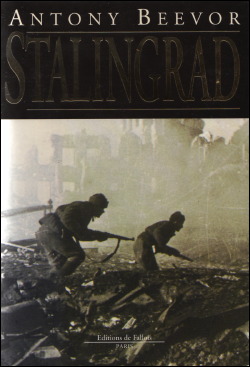
Son histoire de la guerre d’Espagne, publié en 2006, était extraordinaire. Mais avant de raconter les Brigades internationales et la chute de Barcelone, Antony Beevor s’était illustré avec deux livres qui racontaient l’effondrement de la puissance nazie : La chute de Berlin et surtout Stalingrad. Pour ceux que l’Histoire de la deuxième guerre mondiale n’attire pas particulièrement, rappelons que la bataille de Stalingrad, qui dura de l’été 1942 à la fin janvier 1943, a probablement marqué un tournant décisif dans le déroulement de la guerre. Après une période de conquêtes faciles entre 1939 et 1941, la décision d’envahir la Russie précipite le régime nazi dans un gouffre qui engloutira avec lui des millions de vies humaines. Et quand, à l’été 1942, Hitler décide de conquérir Stalingrad coûte que coûte, il se heurtera à l’intransigeance, tout aussi criminelle, de Staline, qui refuse de céder le moindre mètre carré de terrain.
Ce que montre remarquablement bien Beevor, c’est que cette bataille, commencée avec tous les attributs de la guerre moderne — avions, DCA, chars d’assaut — s’est très vite enlisée dans un combat primitif qui n’avait rien à envier aux épouvantables guerres napoléoniennes. L’immensité des territoires, les conditions climatiques extrêmes (poussière en été, bourbiers en septembre, froid terrible en hiver), les atrocités commises contre les populations civiles, les décisions absurdes prises aussi bien par Hitler que par Staline vont aboutir non seulement à la plus lourde défaite de l’armée allemande mais à une boucherie innommable.
Et pourtant, au milieu de ce trou noir de l’histoire humaine que fut Stalingrad, il y eut des gestes d’humanité qu’Antony Beevor relève scrupuleusement, comme autant de petits points de lumière, fragiles mais vivants. Des civils qui venaient secourir des soldats, des officiers, trop peu nombreux, qui refusaient d’obéir aux ordres, des médecins et des infirmières qui soignaient comme ils le pouvaient des blessés et des malades. L’accès aux archives soviétiques, ainsi qu’aux carnets de Vassili Grossman, permet à Beevor de multiplier les témoignages directs qui font de ce livre d’histoire le plus passionnant des romans.
Toute l’histoire pourrait être résumée dans une nouvelle de Tolstoï que Beevor évoque pages 93 et 94. Ecrite en 1886, elle s’appelle Combien de terre faut-il à un homme ? Elle raconte ce qui arrive à Pahom, un riche paysan qui veut acheter de bonnes terres pour une bouchée de pain à des Bachkirs prêts à lui céder à une condition : il pourrait prendre autant de terres que ce qu’il peut parcourir, aller et retour, en une journée. On devine la suite : poussé par son avidité, Pahom va de plus en plus loin et quand il se rend compte qu’il n’aura plus le temps de faire le trajet de retour, il est trop tard. Pahom meurt d’épuisement, les paysans l’enterrent . Conclusion : ce qu’il faut de terre à un homme, c’est six pieds de long, de la tête aux talons.