On a déjà dit sur ce site tout le bien que l’on pense d’un des plus grands historiens du XXème siècle, l’Américain Howard Zinn, auteur d’Une histoire populaire des Etats-Unis. Avant de mourir en 2009, Zinn a fait des émules, notamment Clifford Conner. Celui-ci a publié en 2005 une Histoire populaire des sciences, avec comme projet de rétablir un minimum de justice envers les oubliés de l’histoire des découvertes.
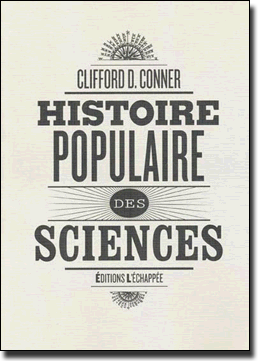
Dans l’ombre imposante d’Albert Einstein, Isaac Newton, Aristote ou Galilée, il y a en effet des millions de chasseurs-cueilleurs, forgerons, marins, horlogers, potiers, cultivateurs ou encore guérisseuses. Longtemps méprisés, considérés comme quantité négligeables parce qu’ils ne savaient pas lire ni écrire, les travailleurs manuels ont pourtant appliqué la maxime de Goethe dans Faust : « Au commencement était le Verbe ? Non. Au commencement était l’action ! »
Et comme il ne recule devant rien, Conner couvre la quasi-totalité de l’histoire humaine, du Néolithique à Internet. C’est un fabuleux voyage auquel il nous invite : la façon dont les chasseurs-cueilleurs pistaient le gibier par l’observation des traces, les techniques de navigation inventées par les marins océaniens bien avant Magellan, le travail du bronze par les forgerons du Moyen-Orient il y a cinq mille ans, la pharmacopée des Incas, les mathématiciens babyloniens, les foreurs de puits chinois atteignant les 1400 mètres de fond un siècle avant JC, la découverte de la perspective par les arpenteurs italiens, l’invention du télescope par un lunetier hollandais...
Son histoire populaire, documentée à l’extrême et portée par un récit très vivant (ce n’est en aucun cas une encyclopédie), montre en fait comment les découvertes essentielles, celles qui avaient pour objectif d’améliorer les conditions de travail ou de vie, ont une origine collective et partagée, partant de la pratique et basée sur l’observation et l’expérimentation. Et comment ces connaissances ont été progressivement monopolisées par une petite caste de savants pour l’essentiel liés à l’Etat et à ses intérêts.
C’est ainsi que la révolution industrielle a dépouillé les artisans de leur savoir-faire et a soumis la recherche à un nouvel impératif : dégager du profit. Le complexe scientifico-industriel, comme l’appelle Conner, est ainsi tout-puissant au vingtième siècle, encore plus quand il est lié, comme pour le nucléaire, à l’armement. On peut en dire autant des semenciers comme Monsanto, des laboratoires pharmaceutiques, ou encore de l’agro-industrie qui loin de nourrir l’ensemble de la population mondiale, organise simultanément la surproduction et la famine.
Car tout comme Zinn, le propos de Conner est politique, en ce sens que pour lui l’histoire est une façon d’expliquer et de comprendre le fonctionnement de notre monde. La prolétarisation de masse, conséquence de la révolution industrielle, la privatisation de la recherche, la domination des experts, l’ambiguité de la notion de progrès, la technologie qui n’a d’autre but que de repousser ses limites quel qu’en soit le prix, tout cela peut se lire comme l’aboutissement d’un processus enclenché il y a deux siècles.
Il reste pourtant des raisons d’espérer. L’Histoire populaire des sciences se termine sur la dernière révolution en cours, celle des nouvelles technologies de l’information, des logiciels libres et d’Internet. Quel meilleur exemple de l’efficacité et de la pertinence de connaissances mises en réseau, partagées, diffusées librement, bref, de la supériorité évidente de la coopération de tous sur la mise en concurrence de chacun ?