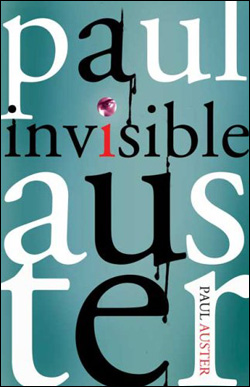
Comment s’y prendre pour raconter une histoire ? Qu’est-ce qui est le plus important : l’histoire ou la narration ? Dans quelle mesure peut-on avoir confiance dans ce qu’affirment des personnages de fiction ? Doit-on croire l’auteur quand il nous assure que ces personnages ne sont qu’imaginaires ? Beaucoup de questions et (presque) pas de réponses : vous êtes bien chez Paul Auster. Si vous détestez les labyrinthes narratifs, les fausses pistes et les récits-gigogne (une histoire dans une histoire dans une histoire), passez votre chemin et optez pour Stephen King. Si vous demandez à un livre de vous embarquer pour une destination inconnue où rien n’est prévisible, alors plongez-vous sans hésiter dans Invisible.
Tout d’abord, une fois de plus, impossible de ne pas penser à Paul Auster lui-même quand il décrit le jeune Adam Walker, étudiant de 20 ans à Columbia, au printemps 1967. Francophile, amateur de poésie, très beau garçon et prêt à tout pour éviter de partir au Viêtnam : toute ressemblance avec un auteur existant ne peut évidemment pas être fortuite. Sauf qu’évidemment, c’est une fausse piste. Adam Walker n’est pas Paul Auster, ni son double, même si comme lui il se rend à Paris à la fin des années soixante. Auster se cache-t-il alors derrière James Freeman, auteur reconnu et ami de Walker, qui prend le relais de la narration au premier quart du roman ?
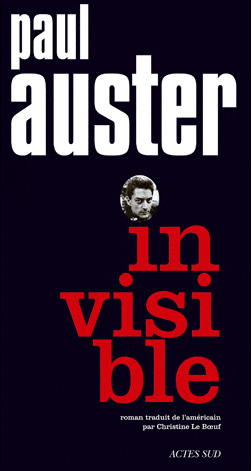
Ce changement de narrateur pourrait nous éloigner de Walker et nous conduire sur une autre piste. Et pourtant non. L’histoire de Walker continue sous une autre forme. L’inquiétant Rudolf Born, mécène aux pulsions criminelles qui se joue de l’étudiant poète comme, disons, un auteur se joue d’un personnage, cède à la place à Gwyn, la sœur de Walker avec qui elle partage un épouvantable secret. Et une complicité qui frôle les limites admissibles jusqu’à ce que...
Le « je » de la première partie cède la place au « tu », même si c’est toujours Walker qui raconte. Mais il y a désormais James Freeman qui joue les intermédiaires entre l’histoire et son narrateur, et qui permettra à ce dernier d’aller au bout de son récit. La troisième partie (appelée « Automne », après « Printemps » et « Eté ») utilise maintenant la troisième personne du singulier, un « il » qui marque l’éloignement — définitif — de Walker avec sa propre histoire, comme des cercles concentriques de plus en plus larges. On quitte Manhattan pour Paris, puis, dans un épilogue déroutant, pour une île caraïbe aussi étrange et irréelle que la jungle terminale d’Apocalypse Now.
Que retenir de ces quelques quatre heures de lecture ? Que s’il n’atteint certes pas les sommets littéraires de Leviathan, Moon Palace ou du Livre des illusions, ni la concision impeccable du Conte de Noël d’Auggie Wren, Invisible nous donne à voir la mécanique austérienne avec beaucoup de plaisir. Un style d’une élégance rare, un art du récit intact et des trouvailles superbes :
« Pour l’essentiel, le dîner d’anniversaire consiste en une conversation divisée en trois épisodes. Le repas est servi et mangé, et, une fois que le dialogue en trois épisodes est terminé, un petit gâteau au chocolat apparaît, orné en son centre d’une seule bougie allumée. Vous ne chantez pas la chanson. Vous articulez les paroles à l’unisson, à voix basse, à peine plus qu’un murmure, mais vous ne les chantez pas. Vous ne soufflez pas non plus la bougie. Vous la laissez brûler jusqu’au bout et l’écoutez alors grésiller quand la flamme se noie dans le gâteau au chocolat en train de fondre. »
Tout Auster est là. Simplicité du style, précision de la description, importance du rite, télescopage entre la vie et la mort (puisque la cérémonie décrite est celle de la date anniversaire de la mort d’un être proche). Ce qui fait de lui un des auteurs les plus singuliers et les plus importants de notre époque. Autant dire qu’il est urgent de le lire.