« NOUS SOMMES OBNUBILÉS PAR NOS PROPRES VIES, AU POINT DE LES CONFONDRE AVEC L’HISTOIRE »
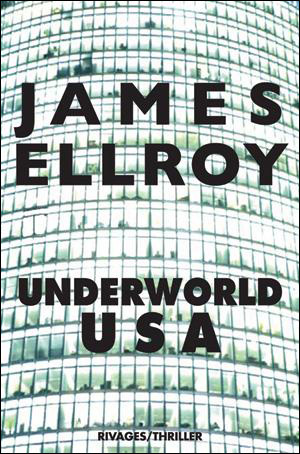
1968 : pendant que la guerre du Vietnam fait rage et que les Etats-Unis perdent pied, Richard Nixon profite du chaos engendré par les assassinats successifs de Martin Luther King et Robert Kennedy pour s’installer à la Maison Blanche, avec la bénédiction de la Mafia et de John Edgar Hoover, le patron complètement décrépi du FBI (qu’il dirige depuis 1924). Ce dernier met d’ailleurs au service du futur président une troupe d’agitateurs chargés de mettre la pagaille dans la campagne du candidat démocrate Hubert Humphrey. Bienvenue dans les années soixante finissantes.
Mais Hoover a d’autres projets, notamment celui de discréditer les organisations noires qui gravitent autour des Black Panthers. Obsédé par la lutte anticommuniste, le n°1 du Bureau charge son agent Dwight Holly de cette mission délicate, et peu importe les moyens. Ellroy tisse d’ailleurs son roman de « documents en encart » particulièrement croustillants, une fausse documentation imaginant des discussions téléphoniques entre Hoover et Holly, ou entre Holly et Nixon, ce dernier se méfiant tout particulièrement de celui qui avait toute sa vie constitué des dossiers sur les huit présidents qu’il avait, s’il on peu dire, servis.

La grande subtilité d’Ellroy, c’est de faire partir Underworld USA [1] quatre ans plus tôt, lors d’un braquage particulièrement sanglant à Los Angeles où un malfaiteur élimine ses complices avant de disparaître avec plusieurs millions de dollars et un stock d’émeraudes. Les mobiles, les commanditaires et les conditions de ce hold-up seront le fil rouge des 800 pages du roman, comme une toile gigantesque réunissant des dizaines de protagonistes entre la Californie, Saint-Domingue et Haïti (époque Duvalier). Le dénouement final remontera d’ailleurs bien plus loin dans le temps, aux sources de la prise de pouvoir de Hoover et des haines personnelles qu’il a engendrées chez les militants de gauche.
On est là, parfois, à la limite de l’asphyxie devant un tel déferlement de personnages aux propos racistes, homophobes, criminels et corrompus jusqu’à la moelle. Mais la littérature, on le sait, n’est pas faite de bons sentiments, et ce monde de la loi et l’ordre version années soixante n’était assurément pas celui des Bisounours. Les flics californiens tenaient des tableaux de chasse de militants noirs abattus sans sommation, et la mafia blanchissait l’argent sale avec la complicité des autorités moyennant quelques menus services.

Et pourtant, contrairement aux deux premiers opus de la série [2], Underworld USA ne se complait pas uniquement dans la peinture violente et sordide d’une Amérique malade. En plaçant ses agents du FBI et ses flics de Los Angeles au contact des mouvements noirs qu’ils doivent infiltrer et des militants de gauche qu’ils recherchent, Ellroy leur donne une chance, une toute petite chance de se racheter.
En écrivant des extraits du journal de la militante clandestine Karen Sifakis, ou de son amie Joan Rosen Klein, sa prose change. Au stacatto haletant (des phrases de cinq mots, pas de virgules) succède un rythme plus fluide, plus réfléchi, presque introspectif. Ces passages, mêmes rares, sont autant de bouffées d’oxygène pour le lecteur, qui suit avec impatience (et malgré tout, espoir) la conversion progressive de l’armada macho et ultraréac d’Ellroy. C’est ce qui fait — avec le dénouement final qui boucle le braquage de 1964 dans une histoire bien plus large — d’Underworld USA un roman éprouvant mais passionnant.
Difficile de trouver un individu plus éloigné d’Howard Zinn que James Ellroy, conservateur assumé, favorable à la peine de mort, opposé à l’impôt et qui se revendique clairement capitaliste [3]. Et pourtant : Underworld USA peut aussi se lire comme un hommage rendu par le second au premier, qui s’est battu toute sa vie au côté des militants des droits civiques contre cette Amérique du sous-sol. La mort d’Edgar Hoover, symbole de ce que les Etats-Unis ont pu engendrer de pire au sommet de l’appareil d’Etat, clôt la trilogie comme une page qui se tourne.
Sur la question de la traduction et des problèmes qu’elle pose, je vous conseille vivement l’émission D@ns le texte animée par Judith Bernard visible sur le site d’Arrêt sur Images (sur abonnement), avec le traducteur d’Ellroy, Jean-Paul Gratias. En voici un extrait :
Traduire, est-ce trahir ? D@ns le texte
envoyé par asi. - L’info internationale vidéo.